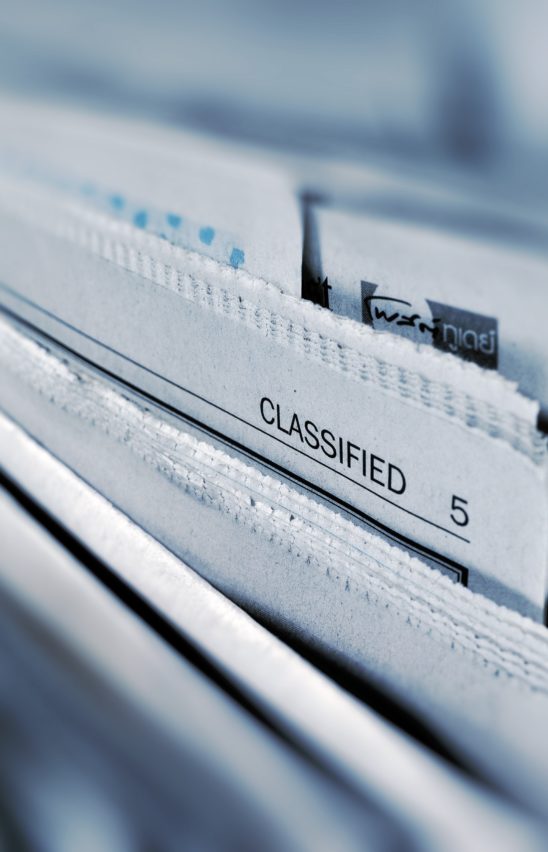
Notre regard sur les débats autour du « fact-checking » et du journalisme de données
Depuis l’avènement et la démocratisation de l’accès à Internet, nous assistons à deux phénomènes en apparence contradictoires : la mise à disposition d’un nombre toujours plus important de données permettant aux citoyens de toujours mieux s’informer, d’une part, la diffusion et le partage toujours plus rapide et toujours plus large d’ « intox » en particulier sur les réseaux sociaux, d’autre part.
Dans un élan d’optimisme, nous aurions pu imaginer que la multiplication de l’accès aux sources et à des formats de vulgarisation comme la data-visualisation et l’infographie, sonneraient le glas de l’approximation, de la rumeur voire de la désinformation…, le journalisme de données (data-journalism) et le fact-checking (la vérification des faits) devenant la règle au sein des rédactions.
Mais cette vision idyllique est encore loin d’être une réalité, en témoignent les derniers échanges entre Samuel Laurent (journaliste des Décodeurs du Monde) et certains de ses confrères sur le pic de pollution à Paris. La genèse de l’histoire, à découvrir au travers de cette dépêche AFP : un « expert » s’interroge sur Twitter, visuel à l’appui : « Pourquoi aucun média ne parle de l’éléphant dans la pièce à l’origine de cette pollution, les centrales à charbon allemandes ? », rejetant la faute de la pollution au sein de la capitale française sur nos voisins et amis d’outre-Rhin. Son tweet est partagé près de 2000 fois. Vérification faite par France Info, puis Le Monde à deux reprises (ici, puis ici), l’argument ne tient pas. Quelques jours après cet épisode et à la suite de débats « houleux » sur les réseaux, Samuel Laurent publie une tribune éclairante et quelque peu désabusée sur la possibilité de détricoter le vrai du faux sur les réseaux sociaux : « Comment meurent les faits : autopsie de la propagation d’une intox ».
Fait notable, des journalistes de la presse d’information généraliste (dont Stéphane Soumier, directeur de la rédaction de BFM business) partagent les théories de l’« expert » de l’environnement sur Twitter et saisissent cette opportunité pour critiquer le fact checking, son caractère « donneur de leçons » et les confrères qui s’appuient sur cette méthode.
Ce débat entre journalistes nous éclaire sur la nécessité du croisement des sources dans un monde de lecture rapide, de digitalisation de l’information et de profusion des données. Comment s’assurer que ce que nous lisons est vérifié et contextualisé ? Si nous avons désormais accès à une quantité infinie de données grâce à nos smartphones, quelques clics sont nécessaires pour vérifier une affirmation ou annonce, exercice chronophage que nous ne pratiquons pas toujours.
Si la vérification et la contextualisation des données est une pratique positive, elle devrait inciter les hommes politiques, les institutions, les entreprises et les journalistes, à une rigueur, une cohérence et une précision aujourd’hui encore plus importante qu’hier. Car Internet n’oublie pas.
Le fact-checking peut et doit également être utilisé par l’ensemble des parties prenantes au débat public comme les organisations professionnelles (c’est par exemple ce que fait le LEEM au travers d’un site dédié), ou les collectivités (ce qu’a fait la ville de Nice plus récemment pour remettre en cause une émission d’investigation à charge).
Notons enfin que la désinformation est devenue un sujet majeur de préoccupation au sein du premier réseau social, Facebook, qui a annoncé mi-décembre la mise en place d’un outil intégré à la plate-forme, qui s’appuiera désormais sur les utilisateurs du réseau ainsi que sur la mise en place d’un partenariat avec des fact-checkers indépendants pour alerter les internautes des « intox » partagées sur leur mur via un message d’avertissement.
Pour entrer du bon pied dans cette nouvelle année, voici une liste des principales rubriques de fact-checking et de data-visualisation que l’on peut aisément consulter.
Quelques références « fact checking » en France :
Rubriques de journaux :
Les décodeurs, Le Monde
Désintox, Libération
Les Pinocchios de l’Obs, Le Nouvel Observateur
Le Scan politique du Figaro, Lefigaro.fr
Détecteur de mensonges, Journal du Dimanche et Jdd.fr
Emissions de radios :
Les observateurs, France 24
Le vrai du faux, France info
Blog :
Acrimed.org
Le démonte rumeur, Rue89
Quelques références « fact checking » aux USA et en Angleterre :
Rubriques de journaux :
Reality Check, The Guardian
Fact Checker, The Washington Post
Blog :
Factcheck.org
Politifact
Fullfact.org
Arnaud Terrisson
