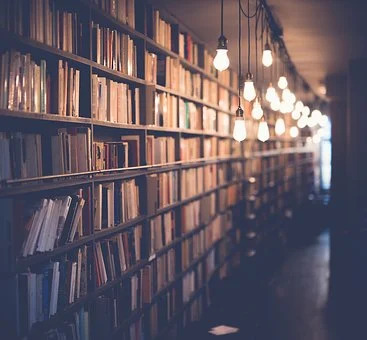
Notre regard sur la communication de l’exécutif sur l’affaire Benalla
L’intervention d’Emmanuel Macron devant les parlementaires de la République en Marche le 24 juillet constituera à l’évidence un épisode essentiel du feuilleton qu’est devenue l’affaire Benalla. Elle marque un tournant dans la communication de l’exécutif sur celle-ci et contribuera, comme les précédents à en faire un cas à étudier dans les facultés. Pour y faire référence comme l’exemple de ce qu’il faut faire ou ne faut pas faire ! L’illustration aussi, que, dans des situations de crise, les actions engagées pour les surmonter contribuent souvent à les aggraver.
Face à la révélation par le journal Le Monde le 18 juillet de l’identité de l’homme filmé le 1er mai, place de la Contrescarpe, en train de frapper un manifestant à terre, une vidéo déjà vue 120 000 fois un mois et demi plus tard, l’exécutif avait deux stratégies :
– celle de « l’aveu » : réagir immédiatement, prendre la parole pour déclarer inacceptable le comportement du chargé de mission et en tirer les conséquences à l’égard de ceux qui, ayant géré le dossier, ont proposé une simple sanction de quinze jours de suspension pour des actes aussi graves, avec l’espoir d’arrêter ainsi la polémique avant qu’elle ne soit devenue une affaire d’Etat,
– celle de « l’édredon » ou du déni : se contenter de quelques dénégations « molles » et attendre que cela se passe, qu’un autre sujet chasse celui-ci.
C’est manifestement la deuxième voie qui, choisie dans un premier temps par l’Elysée, a été mise en œuvre dans des conditions d’improvisation évidentes et a conduit l’exécutif dans une impasse dont il a du mal à sortir.
Dans l’article publié par Le Monde, le directeur de cabinet du Président confirme et les faits et la sanction infligée. Le lendemain, c’est au porte-parole de l’Elysée de monter au front pour souligner la gravité de cette sanction « la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission de la Présidence ». Et de préciser que les attributions d’Alexandre Benalla ont été modifiées et restreintes à des tâches administratives et à la préparation des manifestations à l’intérieur du Palais.
S’engage alors une course aux archives vidéo pour montrer la présence de l’intéressé à proximité du Président au Panthéon le 30 juin et à la Concorde le 14 juillet. Ou bien encore, seul cette fois-ci, dans le bus qui amène les Bleus vers les Champs-Elysées le 16. Dans le même temps, les médias commencent à rapporter des exemples du comportement autoritaire et emporté d’Alexandre Benalla, qui n’a pas hésité par exemple, ce-même 16 juillet sur le tarmac de Roissy où sont attendus les héros de Moscou, à donner publiquement, à haute voix et de manière rugueuse, des instructions au responsable de la gendarmerie en charge des opérations. Puis, on apprendra que le chargé de mission s’est vu attribuer un logement de fonction dans l’annexe de l’Elysée, quai Branly le… 7 juillet, un mois et demi après la fin de sa suspension. Le feuilleton tourne à plein, chaque épisode relance la machine et compromet toujours davantage la stratégie de l’édredon.
Cela d’autant plus que, « pour mieux préparer sa défense », Alexandre Benalla a demandé et obtenu dès le 18 juillet de plusieurs responsables de la Préfecture de Police la communication des enregistrements des incidents du 1er mai. Une deuxième affaire dans l’affaire. L’apprenant le 19 juillet, le Préfet de Police prend immédiatement l’initiative de dénoncer les faits au Procureur de Paris en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, ce qui souligne a contrario l’inaction de l’Elysée, du Ministre de l’intérieur… et du Préfet lui-même après le 1er mai.
Comment éviter dès lors que le sujet glisse rapidement sur le terrain politique ?
L’opposition, de droite comme de gauche, s’empare de l’affaire et profite de la tribune offerte par le débat sur la réforme constitutionnelle pour mettre en cause le ministre de l’intérieur puis le Premier ministre et enfin le Président lui-même, à travers des rappels incessants au règlement. Le travail parlementaire est vite paralysé. La posture d’indifférence affichée par l’exécutif, le Président répondant aux journalistes qui l’interrogent le 19 juillet sur l’affaire « cela n’intéresse que vous » ou le Premier ministre qui suit une étape du Tour de France le lendemain expliquant au micro de France 2 « c’est un rêve d’enfant… c’est incroyable d’être ici… », ne fait qu’exciter l’opposition et entretenir la polémique.
Les défenses de la majorité présidentielle et de l’exécutif cèdent les unes après les autres. Vendredi, ils acceptent une commission d’enquête, samedi matin, sont annoncés le licenciement d’Alexandre Benalla puis le report de l’examen du projet de loi constitutionnel, le dimanche, l’Elysée indique que le Président a tenu une réunion, vite qualifiée de crise par les médias. Son entourage tient à faire savoir que le Président a déclaré à ses interlocuteurs que l’attitude de son ancien collaborateur était « choquante et inacceptable » et « qu’il n’était pas question de laisser accréditer l’idée d’une quelconque impunité ». Il aurait reconnu l’existence de dysfonctionnements et demandé à son secrétaire général une proposition de réorganisation des services de la Présidence. Le feuilleton s’amplifie.
Lundi, le Président indique qu’il renonce à aller suivre une étape du Tour de France dans les Pyrénées alors que s’ouvrent les auditions de la Commission d’enquête créée par l’Assemblée nationale. Et rien, après avoir entendu le Ministre de l’intérieur, le Préfet de Police puis le Directeur de cabinet du Président témoigner, ne permet de penser que les travaux des députés vont conduire à éloigner la crise de l’Elysée. Bien au contraire, à entendre chacun d’entre eux, souligner à travers des phrases pesées au trébuchet, sa solidarité pour mieux affirmer son absence de responsabilité sur le fond, on comprend que la communication de l’exécutif risque de se transformer en guerre de tranchée délétère, voire mortifère.
Il devient évident que la stratégie de l’édredon n’a fait qu’amplifier et nourrir la crise médiatique au risque de déboucher sur une crise politique majeure. Son choix révèle une erreur d’analyse de la situation qui s’ajoute à celle commise au lendemain du 1er mai.
Une rupture s’impose.
Elle viendra de l’intervention du Président qui impose un changement de cap à 180 degrés. De la stratégie de l’édredon, on passe à celle de l’aveu. Mais un aveu à la mode Macron, puisqu’il se présente comme une revendication, celle d’une responsabilité pleinement assumée ! En deux phrases pour clamer qu’il est seul responsable, en refusant une République des fusibles et des fonctionnaires sanctionnés, Emmanuel Macron retrouve le registre jupitérien dans lequel il excelle. Le choix des modalités est également judicieux : il permet de créer la surprise sans pour autant avoir la solennité d’une intervention à la télévision forcément plus dangereuse. Le Président coupe court à toute discussion sur le rôle de ses collaborateurs et évite d’en faire le feuilleton de l’été.
On a là tous les éléments d’une reprise en main de la situation médiatique : une affirmation forte et claire, à un moment et sous une forme que personne n’attend. L’initiative et la maîtrise du débat médiatique changent de camp. Encore aurait-il fallu qu’Emmanuel Macron limite ses propos à ses deux phrases, la suite et notamment le désormais célèbre « qu’ils viennent me chercher » faisant redescendre Jupiter de son Olympe et ne pouvant que relancer la polémique la plus politicienne. Et ses déclarations le lendemain, lors de son déplacement dans les Pyrénées, mettant en cause le travail des médias, s’apparentent à un début de mise en œuvre de la troisième des stratégies habituellement mises en œuvre pour faire face à une situation de crise. Après le déni et la revendication est venu le temps du détournement.
Un vrai cas d’école !
